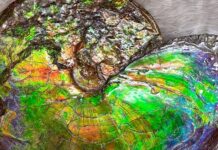Les villes du monde entier sont aux prises avec une crise croissante de santé mentale. Alors que les espaces verts urbains sont prometteurs en tant que solution rentable pour améliorer le bien-être, la question de savoir dans quelle mesure le vert est réellement bénéfique reste floue. Une nouvelle étude publiée dans Nature Cities par des chercheurs de l’Université de Hong Kong (HKU) apporte une réponse définitive : des quantités modérées de verdure urbaine sont essentielles pour maximiser les bienfaits psychologiques, remettant en question l’hypothèse selon laquelle « plus de vert, c’est toujours mieux ».
L’Organisation mondiale de la santé estime qu’une personne sur huit dans le monde vit avec un trouble mental, mais le traitement reste inaccessible pour la plupart. L’écologisation urbaine a gagné du terrain en tant que solution potentielle en raison de ses liens avérés avec la réduction du stress, de l’anxiété et de la dépression, ainsi qu’avec l’amélioration des fonctions cognitives. Cependant, les études précédentes ont donné des résultats incohérents, ne parvenant pas à établir des objectifs clairs pour les urbanistes. Cette nouvelle recherche comble cette lacune critique en analysant des décennies de données mondiales pour révéler la « dose » optimale de verdure pour le bien-être mental.
Dirigée par le professeur Bin Jiang, l’équipe a mené une analyse rigoureuse couvrant 69 études quantitatives publiées entre 1985 et 2025. Ils ont examiné des données provenant de cinq continents, englobant plus de 500 ensembles de données et représentant divers types d’espaces verts vus du niveau de la rue et d’en haut. La méta-analyse a confirmé une relation cohérente en forme de U inversé : les bienfaits pour la santé mentale augmentent avec l’augmentation de la verdure jusqu’à un seuil modéré, se stabilisent à ce stade, puis diminuent, devenant potentiellement préjudiciables au-delà de ce point.
Trouver un équilibre : les seuils verts optimaux
Les résultats révèlent des seuils spécifiques pour la verdure à la hauteur des yeux (ce que les gens ressentent lorsqu’ils naviguent dans la ville) et la verdure descendante (approchée par l’imagerie satellite). Pour les vues au niveau de la rue, les avantages culminent à une couverture verte de 53,1 %, avec une fourchette très bénéfique comprise entre 46,2 % et 59,5 %, et une fourchette non défavorable de 25,3 % à 80,2 %. Les perspectives descendantes montrent une tendance similaire, culminant à 51,2 % avec une fourchette très bénéfique entre 43,1 % et 59,2 % et une fourchette non défavorable allant de 21,1 % à 81,7 %. Ces résultats s’alignent sur des théories établies comme la loi Yerkes-Dodson, qui suggère que la performance optimale (dans ce cas, le bien-être mental) se produit à des niveaux de stimulation modérés.
Implications pratiques pour les villes : planifier le bien-être mental
Cette recherche offre un cadre puissant aux urbanistes et aux responsables de la santé publique. Plutôt que de donner la priorité à un verdissement implacable, les villes peuvent désormais cibler ces seuils spécifiques pour maximiser les bienfaits sur la santé mentale tout en optimisant l’allocation des ressources. La verdure à la hauteur des yeux le long des rues et des espaces publics apparaît comme particulièrement cruciale, justifiant la priorité dans les considérations de conception. Les seuils établis permettent également aux planificateurs de fixer des niveaux minimaux de couverture verte pour préserver le bien-être mental et éviter une diminution des rendements au-delà d’un certain point. Cette approche ciblée soutient une répartition plus équitable des terrains urbains et des ressources d’entretien.
“Ce travail démontre comment les interventions environnementales peuvent relever des défis critiques de santé publique”, explique le professeur Peng Gong, vice-président et pro-vice-chancelier (développement académique) à HKU et membre de l’équipe de recherche. “Cela fournit des preuves indispensables pour atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé, au bien-être et aux villes durables.”
Le professeur Jiang souligne que la contribution la plus significative réside dans l’établissement d’une relation curviligne généralisée entre la verdure et les résultats en matière de santé mentale. Il souligne en outre deux points clés : premièrement, démystifier le mythe selon lequel « plus de vert, c’est toujours mieux », en soulignant les inconvénients potentiels d’un verdissement excessif ; deuxièmement, démontrer comment des espaces verts modérés sont suffisants pour offrir des avantages optimaux tout en évitant la surallocation des ressources. Cet équilibre délicat est particulièrement pertinent pour les villes densément peuplées comme Hong Kong, où la maximisation des espaces verts entre souvent en conflit avec d’autres besoins urbains urgents.
Le professeur Chris Webster, professeur titulaire de la chaire d’urbanisme et d’économie du développement à HKU, résume le double impact de l’étude : « Nous avons fourni des preuves solides d’une relation curviligne qui met fin à des décennies de résultats fragmentés. Deuxièmement, nous avons traduit ce modèle en valeurs seuils pratiques qui éclairent directement les directives de verdissement et les normes d’aménagement paysager.
En proposant des orientations claires pour obtenir des bénéfices optimaux en matière de santé mentale grâce au verdissement urbain, cette recherche permet aux villes de prendre des décisions plus éclairées concernant l’allocation des ressources et de donner la priorité au bien-être de leurs citoyens.